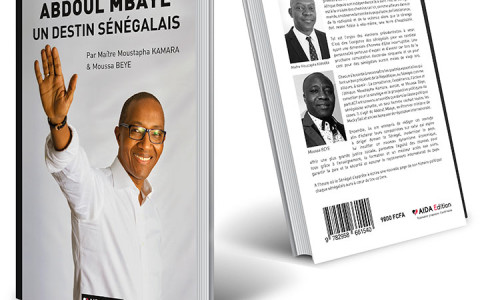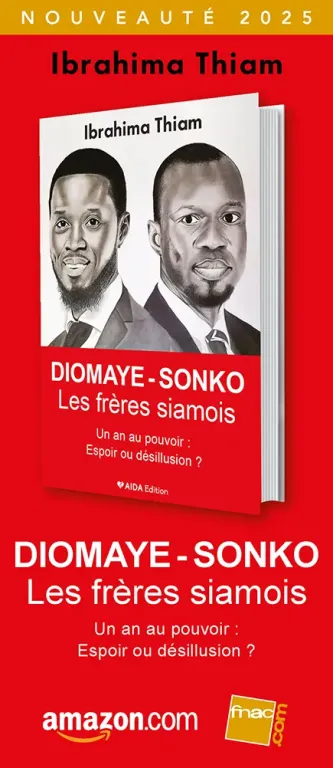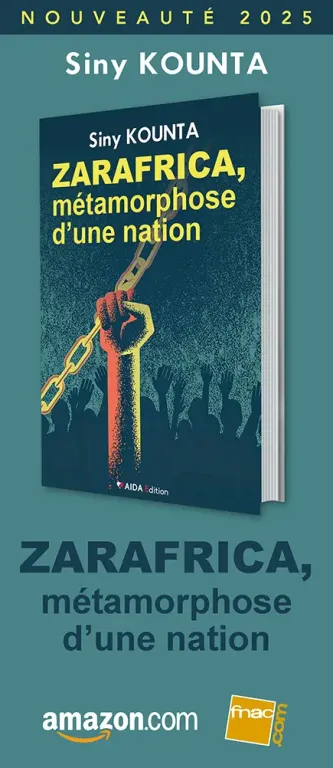Thiaroye : Histoire et mémoire d'un massacre colonial au Sénégal
Le 1er décembre 1944, à proximité de Dakar au Sénégal, au camp de Thiaroye, plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais, peut-être davantage, trouvèrent la mort. Ces hommes, originaires de toute l’Afrique subsaharienne francophone, avaient pour la plupart quitté l’Afrique en 1939-1940, enrôlés par l’armée française. Après la débâcle de l’armée française au printemps 1940, ils avaient passé les années de guerre comme prisonniers. À Thiaroye, ils furent tués, sur ordre des autorités coloniales françaises, simplement pour avoir réclamé leur dû : pécule et autres primes de démobilisation.
Soixante-dix ans plus tard, François Hollande remettait au président sénégalais, Macky Sall, les archives de ce drame, signe que ce passé est aujourd’hui de plus en plus tangible. Ce drame a touché en premier lieu les soldats africains de l’Empire français, mais il est une mémoire douloureuse de cet événement pour l’ensemble de la société sénégalaise, depuis le moment où il est advenu jusqu’à nos jours. Comment restituer alors la construction de cette mémoire depuis soixante-dix ans et que signifie encore cet événement aujourd’hui ?
Thiaroye est un « lieu de mémoire », pour reprendre la célèbre expression d’un historien. La formule est belle. Thiaroye serait cet endroit « matériel, symbolique et fonctionnel [1] » d’où a émergé un « quelque chose » qui continue de faire sens. Pourtant, au-delà de l’expression, les propositions de Pierre Nora, qui tendent à opposer radicalement l’histoire et la mémoire, obscurcissent peut-être les dynamiques en n’expliquant ni la circularité, ni les interactions constantes de ce « couple infernal que forment la “mémoire”et l’“histoire” [2] ».
Si décrire l’historicité du souvenir de l’événement du 1er décembre 1944 au Sénégal consiste, dans un sens, à saisir un contexte local dans ce qui s’apparente à une « mondialisation de la mémoire [3] », il ne s’agit pas de décliner une alternative entre « devoir de mémoire » ou ce qui serait de l’ordre de l’« abus de mémoire [4] ».
Il convient, à l’inverse, de comprendre comment Thiaroye en est venu à être considéré comme une métaphore de la violence et de l’injustice coloniale. Le présent ouvrage est issu d’une thèse intitulée De Thiaroye, on aperçoit l’île de Gorée. Histoire, anthropologie et mémoire d’un massacre colonial au Sénégal, soutenue en histoire et en anthropologie [5].
Gorée est ce caillou dans l’océan Atlantique au large de Dakar, une île devenue le symbole de la traite négrière et la mémoire sénégalaise de Thiaroye doit d’abord se lier à ce temps long ouest-africain marqué par cette violence déshumanisante. Achille Mbembe, en parlant de la présence « fantomale » de ce passé, écrit :
« Seul compte l’enroulement de l’expérience. Les choses et les événements s’enroulent les uns sur les autres. Si les histoires et les événements ont un début, ils n’ont pas forcément de fin proprement dite. Certes, ils peuvent être interrompus. Mais une histoire ou un événement peuvent se poursuivre dans une autre histoire ou dans un autre événement, sans qu’il y ait nécessairement une filiation entre les deux. Les conflits et les luttes peuvent être repris au point où ils s’étaient arrêtés […]. Tout fonctionne, par conséquent, selon le principe de l’inachèvement. Du coup, le rapport entre le présent, le passé et l’avenir n’est plus ni de l’ordre de la continuité, ni de l’ordre de la généalogie, mais de celui de l’enroulement de séries temporelles pratiquement disjointes, reliées l’une à l’autre par une multiplicité de fils ténus [6]. »
En ce sens, la perception de l’histoire des soldats qui tombèrent à Thiaroye a d’abord affaire à une expérience collective de violence extrême, antérieure au processus colonial. Le récit qui suit est dans un premier temps une « anthropologie historique d’un massacre d’état » pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Alain Dewerpe à propos de la répression du métro de Charonne à Paris en janvier 1962 [7].
Il s’agit d’établir ce qui se joue lors de cette matinée du 1er décembre 1944 dans l’espace plus ou moins clos du camp militaire et, à la lecture de différents fonds d’archives coloniaux, de percevoir ce que comprennent les officiers français, les tirailleurs africains et la société dakaroise de ce drame. C’est, ensuite, une histoire de la mémoire de cette répression dans l’espace national sénégalais jusqu’à nos jours. Cependant, repérer les régularités objectives et situées du surgissement de cet événement depuis plus de soixante-dix ans, localiser socialement ce souvenir, n’épuise pas la problématique du rapport à ce passé.
Gorée et Thiaroye
Aujourd’hui, les processus de reconstruction de l’événement s’ancrent dans un terrain singulier, celui de la société sénégalaise du début du XXIe siècle. Les dynamiques liées à ce passé doivent se lier à un autre terme, celui d’imaginaire qui renvoie à « la capacité élémentaire et irréductible d’évoquer une image [8] » et dont ce « que nous appelons “réalité” et “rationalité” en sont des œuvres [9] » pour reprendre les termes de Cornelius Castoriadis.
Il a fallu ainsi, de manière ethnographique, susciter ce passé pour en percevoir justement les ressorts. Cette mémoire contemporaine de la violence coloniale n’est pas celle d’une violence cyclique, mais bien d’un événement singulier et les représentations de Thiaroye sont celles de représentations partagées qui renvoient à des temporalités collectives.Partagées ne veut pas dire ici identiques mais ces représentations s’ancrent dans un langage commun où les arguments qui construisent le rapport à ce passé répondent, en écho, à d’autres perceptions.
Ce sont ces variations de ce souvenir qui constitue l’objet d’analyse. S’intéresser alors à ces « expériences de l’histoire [10] » pose une question sous-jacente : le champ des possibles offert par la mémoire. En ce sens, cet ouvrage est un travail sur le temps au Sénégal, dans sa « double structure : celle d’un présent éternel vécu, qui est l’essentiel, et celle d’une succession conceptuelle et sociale du temps présent, passé et à venir [11] » pour reprendre des propositions avancées par Maurice Halbwachs quant à la notion de « mémoire collective (Halbawachs Maurice, La mémoire collective, op. cit) ». Situer ce champ de la mémoire, c’est examiner des rationalisations de l’histoire ; c’est établir une sociologie de la transformation des répertoires historiques que l’on doit replacer dans un tissu complexe de relations, personnelles, sociales et militantes, portées par différents acteurs et qui forment l’espace politique sénégalais depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais cet espace national de la mémoire entre en interaction avec d’autres espaces.
L’événement qui se déroule à Thiaroye le 1er décembre 1944 est contemporain des crimes de masses qui ont lieu à cette époque en Europe et, en premier lieu, le génocide juif. Ces passés renvoient à des réalités historiques diverses, peut-être difficilement comparables, et à une hétérogénéité de mémoires. Ce qui compte ici est moins d’interroger les formes que prend la violence extrême que de chercher à repérer le travail de la mémoire dans ses circulations, ses contours, ses biais et ses travers. Les années 1970 sont celles de la résurgence de la mémoire de l’Holocauste au sein de plusieurs échelles [12].
En 1979, le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau est inscrit sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO, un an plus tôt c’était l’île de Gorée qui faisait l’objet du même classement. La trajectoire mémorielle de ces deux lieux qui incarnent deux épisodes historiques, l’Holocauste et la traite négrière, interroge ainsi un rapport global au passé. L’événement devient symbole, il n’est plus le drame qui touche une communauté mais se meut dans un espace de références liées à des passés collectifs. C’est cette dynamique que l’on souhaite observer à travers le souvenir de l’événement du 1er décembre 1944. Thiaroye est un massacre de soldats qui provenaient de Guinée, de Côte-d’Ivoire, du Mali — l’ex-Soudan français —, du Sénégal, du Niger, etc. Le souvenir immédiat de la répression est lié aux luttes qui se jouent dans un cadre politique donné, l’Afrique occidentale française (AOF). Cette première temporalité de la mémoire de Thiaroye dure quinze ans, jusqu’en 1960. À cette date, le Sénégal devient indépendant. S’intéresser aux luttes politiques qui revendiquent le souvenir de la répression à partir de ces années-là, puis pendant plus de cinquante ans, c’est proposer une autre histoire du Sénégal, une histoire à la fois politique, sociale et culturelle. L’étude de la trajectoire de cette mémoire intègre donc, en tentant de les faire dialoguer, trois « bibliothèques », celle qui concerne la mémoire en sciences sociales, celle qui prend le colonialisme pour objet, et spécifiquement les tirailleurs, celle, enfin, qui s’intéresse à la construction de l’État-nation sénégalais.
Ce livre est un livre d’histoire mais c’est aussi un livre sur le rapport à l’Histoire, sur « comment on écrit l’histoire [13] », sur le rapport au récit, ses règles narratives, les présupposés méthodologiques de la discipline comme ceux de l’anthropologie ou des études littéraires. La question demeure : en un sens, peut-on ethnographier le passé et, de plus, comment historiciser le présent ? On doit indéniablement à Ann Laura Stoler la réflexion la plus poussée sur cette question. À travers une recherche sur ce qui est dit mais aussi ce qui est tu dans les archives coloniales néerlandaises, en suivant leur grain textuel — Along the grain d’après le titre de son ouvrage —, en montrant que ces archives étaient une matière vivante, en proposant de les aborder moins comme des sources biaisées que comme des sujets actifs, Stoler montre que ces documents représentent des lieux condensés de l’anxiété politique coloniale [14].
L’analyse des archives coloniales, celles produites par les autorités françaises, s’exécute dans une pluralité d’espaces de production du document, à travers les rapports des sous-officiers et d’officiers présents au camp militaire le 1er décembre 1944, pendant l’instruction, lors du procès, comme dans les rapports destinés au pouvoir civil, notamment les rapports de synthèse envoyés en métropole. Ainsi, la mort violente des tirailleurs à Thiaroye engage au moins deux points de vue, celui de ceux qui tuent et celui de ceux qui sont tués. De fait, il est difficile d’avoir celui des hommes qui sont morts. Les archives sont donc celles des premiers. Amar Fall, pour ne citer que lui, est mort à cause d’une « violence légitime », celle de l’État. Plus que l’État colonial, il fut tué par des militaires de l’armée française qui ont leur propre compréhension de la situation dans la matinée du 1er décembre. En restituant les paroles de ceux qui exercent la violence, ce livre est également une histoire du mensonge, de la duperie, des documents falsifiés que produit l’armée et plus généralement le pouvoir colonial. Mais le drame qui fonde le souvenir n’est pas réductible à cette vision française qui le met en forme. Dans les minutes qui suivent la tuerie, des tirailleurs considérés comme les meneurs de cette « mutinerie » sont arrêtés, puis trente-quatre d’entre eux sont jugés en mars 1945 et condamnés à des peines d’emprisonnement allant de un à dix ans de prison.
Les archives de la justice militaire nous permettent aujourd’hui de savoir qui étaient ces tirailleurs et, dans une certaine mesure, de connaître leurs sentiments sur ce qui s’est joué pour eux. Surgit alors une autre question d’ordre méthodologique : comment raconter ces vies alors que, pour la plupart d’entre eux, on ne dispose que d’une date et d’un lieu de naissance, du nom des parents, d’une profession — presque tous sont cultivateurs —, et de quelques détails physiques ?
La mémoire de Thiaroye au Sénégal
Les dates en histoire sont des outils pour comprendre des mentalités et des comportements. Ordonnées et se succédant, elles n’ont de sens que rapportées à d’autres dates dans le récit que cherche à construire le narrateur. La mort de ces tirailleurs, et non leur vie, est l’événement qui fonde le récit de son souvenir. La compréhension des mémoires attachées à ce drame, en aval, est la saisie d’une mémoire attachée aux protagonistes des événements de Thiaroye. Si un des objets de ce travail est de chercher les acteurs et les voix qui proposent telle ou telle interprétation de ce massacre, l’on doit s’intéresser également à une histoire du vocabulaire qui raconte Thiaroye. La mort des tirailleurs doit être replacée dans une réflexion sur la violence coloniale de cette époque : plus de quinze ans qui, jusqu’en 1962 et la fin de la guerre d’Algérie, ont été plus meurtriers que la violence de la conquête qui se déroule en Afrique de l’Ouest sur plusieurs décennies à partir du dernier quart du XIXe siècle [15]. Mais, en amont de l’événement, il s’agit de retracer la genèse de la « figure » du tirailleur. Les tirailleurs furent ce corps militaire créé en 1857 et qui participe aux deux guerres mondiales, tout en étant une force de maintien de l’ordre dans l’ensemble de l’Empire français pendant un siècle. S’il convient de traiter, dans un premier temps, « la métropole et la colonie dans le cadre d’un seul et même champ analytique, en nous interrogeant sur l’influence que l’on accorde aux connexions causales et à la primauté des intermédiaires dans ses différentes composantes [16] », on peut poursuivre cette réflexion en intégrant les imaginaires d’une société sénégalaise postcoloniale, confrontée à une société française également postcoloniale. Ainsi, on a parfois coutume de dire, dans les rues de Dakar, que « quand la France s’enrhume, le Sénégal éternue ». Le drame qui se déroule au camp de Thiaroye est le fait des autorités coloniales françaises. Le récit de sa mémoire jusqu’à aujourd’hui concerne, dans les propos mêmes des individus qui construisent son souvenir, de Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Sarkozy ou Hollande.
Thiaroye est lié au roman national sénégalais. Le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale signifie en Afrique occidentale – et plus généralement dans « les tiers-mondes » – une intensification des luttes syndicales et politiques. C’est à ce prix que l’on comprend comment le souvenir de la répression s’est inscrit dans une géopolitique de la mémoire qu’il s’agit alors de cartographier. Le moment de l’indépendance signifie certes un changement de pouvoir mais, dans la perspective de la recherche des traces de la mémoire de Thiaroye, il implique d’abord un changement dans la nature des sources disponibles. La presse sénégalaise depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui a été largement mobilisée. Plus d’une dizaine de journaux ont ainsi été consultés, soit de manière intégrale soit autour de dates clés. Cette presse peut se diviser, certes de manière un peu schématique, en deux parties : celle du pouvoir et celle de l’opposition. Cette dernière est clairsemée. Elle est interdite peu après 1960, et de fait difficile d’accès, tandis que l’on trouve plusieurs titres publiés à la fin des années 1970, dans un contexte où le pouvoir socialiste en place réintroduit certaines libertés démocratiques qu’il avait supprimées quelques années plus tôt. Cette presse est militante, elle informe sur les enjeux que se donnent les partis. Les devises des journaux, les jeux de mots, les rubriques culturelles ou encore le choix de photographies informent sur la mobilisation de références historiques et donc sur un espace de la mémoire historique. S’appuyer sur une perspective structurale — l’homologie des récits, des valeurs et des modes d’action — enchâssée au sein de plusieurs chronologies, aide aussi à comprendre l’événement lui-même. Dans la perspective la plus complète de la restitution des traces de l’événement original, rappelé dans les discours des acteurs ou par différents types d’archives — historiques ou littéraires —, chaque appropriation de la répression et sa mise en forme publique peuvent devenir un nouveau levier de représentations partagées du passé, au prix d’un processus de sélection.
Faire l’histoire de la mémoire de Thiaroye, c’est également prendre en charge les arts et la littérature qui mettent en scène ce récit. Les poèmes, pièces de théâtres, le cinéma et les chansons constituent en ce sens un ensemble significatif qui a sa propre historicité et peut s’analyser d’un bloc. Il s’agit moins de procéder à l’examen de ces différentes unités à travers des outils propres à l’analyse littéraire, cinématographique ou musicologique — même s’il a fallu mobiliser partiellement ces outils — que d’inscrire ces œuvres dans une sociohistoire de la mémoire de Thiaroye. Ce cadre de la mémoire fut porté par la gauche sénégalaise mais il renvoie, pour une part, à une mémoire des élites militantes. Ainsi, dans ce qui relève de la « culture populaire [17] », il convient de comprendre ce « populaire ». C’est donc au prix d’un croisement des approches disciplinaires que l’on perçoit le moteur de cette mémoire. De plus, cet ouvrage s’appuie sur près de soixante-cinq entretiens semi-directifs. Si la mémoire est indissociablement liée à la fonction narrative [18], c’est moins la hiérarchie entre les sources que le rapport épistémologique à ces données plurielles qui permet de fonder l’adéquation entre l’objet d’analyse, la mémoire collective, et le sens de cette mémoire. Les personnes interrogées étaient productrices d’une certaine mise en scène de Thiaroye, à partir des années 1950 jusqu’à aujourd’hui. On les a donc questionnées autant pour connaître ce qu’elles « savaient » de Thiaroye, le contexte dans lequel elles avaient appris l’événement, que pour comprendre et interpréter ce qu’elles en « pensaient », le sens qu’elles mettaient dans la lecture de ce massacre.
À partir de l’étude d’un événement de quelques minutes et de la présence de ce passé depuis plus de soixante-dix ans, cet ouvrage est une histoire croisée des imaginaires politiques franco-ouest-africains, et en premier lieu de l’imaginaire qui s’enracine dans la relation de deux termes : l’honneur et la trahison. S’intéresser à la mémoire collective, de manière générale, renvoie à une question quant à la taille du groupe auquel on se réfère : la cellule familiale, la communauté villageoise, la génération politique, la classe sociale ou le parti politique, l’État, etc. Mais moins que la question du groupe en tant que tel, c’est son organisation, « sa structure, car le groupe n’est qu’un système de relations interindividuelles [19] » qui compte. Dans un ouvrage célèbre, L’Imaginaire national, Benedict Anderson s’interrogeait sur la puissance du lien qui unit les membres d’un même territoire. Il proposait d’interroger, suivant différentes séquences historiques, l’émergence de ces « artefacts culturels [20] » que constituent les nations. À travers l’angle qui consiste à interroger, au Sénégal, les mémoires de la répression de Thiaroye, ce livre tente de contribuer empiriquement aux repérages des notions, des valeurs, des figures collectives, des idéaux qui forment une part de cet imaginaire national, tout en gardant à l’esprit qu’il s’inscrit dans un espace ouest-africain plus large.
Ce livre est divisé en six chapitres suivant un découpage chronologique. Le premier chapitre identifie l’évolution des représentations attachées aux tirailleurs sénégalais, notamment autour de la Première Guerre mondiale. La perspective n’est pas celle d’une histoire impériale et l’on tente de comprendre de manière plus complexe le « fait guerrier » en Afrique de l’Ouest au début du XXe siècle. Le deuxième chapitre retrace le déroulement des événements de Thiaroye. À ce titre, et parce que certaines questions factuelles demeurent, l’accent est mis sur le développement mensonger d’une partie des rapports des officiers français présents le matin du 1er décembre 1944. Ces différents documents constituent pourtant les sources principales pour comprendre ce qui s’est passé à Thiaroye. Le chapitre suivant aborde un premier temps de la mémoire du drame, celui dont l’enjeu est de faire libérer les tirailleurs condamnés et encore emprisonnés — cette libération intervient en mai 1947 au moment de la visite du président français Vincent Auriol à Dakar. Le chapitre quatre allonge cette mémoire. On l’aborde dans les quinze années qui précèdent l’indépendance dans un moment de reconfiguration de l’espace politique sénégalais. Le chapitre cinq a pour objet le souvenir de la répression après l’indépendance, quand Senghor prend la tête du pays. Ce souvenir est alors porté par des opposants à ce dernier, d’abord plus ou moins dans la clandestinité puis, alors que le président-poète a quitté le pouvoir, par un film, Camp de Thiaroye, qui est un immense succès au Sénégal, à l’orée des années 1990. Le dernier chapitre définit aujourd’hui la consistance de cette mémoire collective. À partir de 2004, nous assistons à la prise en charge de l’histoire des tirailleurs — et de Thiaroye — par les plus hautes autorités sénégalaises. Outre la description de cette mémoire officielle, il s’agit de s’intéresser à la contemporanéité de ce souvenir, notamment pour la jeunesse.